
Depuis les années 1970, l’Europe a vu se multiplier les détournements d’anciens lieux de travail pour y accueillir des représentations d’opéra. Le phénomène fut d’abord lié à des œuvres spécifiques : durant cette décennie, Jorge Lavelli mit en scène ainsi Al gran sole carico d’amore de Luigi Nono dans une usine désaffectée de Lyon, ou Fidelio dans la Halle aux grains de Toulouse. A Amsterdam, c’est dans une ancienne usine à gaz, la Westergasfabriek, transformée en complexe culturel, que Pierre Audi a monté des œuvres de Claude Vivier. Et voilà que le label Capriccio attire notre attention sur un autre de ces endroits : la Tabakfabrik de Linz. Bâtie dans les années 1930 par Peter Behrens, cette usine fermée en 2009 fut rachetée par la ville, qui en a fait un centre d’art et d’affaires.
Ce cadre insolite ne correspond finalement pas si mal à Ulenspiegel, opéra comme aurait pu en écrire Richard Strauss s’il avait eu une conscience sociale et politique un peu plus développée (même Friedenstag paraît loin du compte). Walter Braunfels a lui-même écrit le livret de son deuxième opus lyrique d’après le roman Till l’Espiègle de Charles de Coster, et l’on y retrouve la lutte des Gueux contre l’occupant espagnol. L’indispensable intrigue amoureuse paraît ici bien secondaire par rapport à la dimension historique de l’œuvre qui met en avant le combat du peuple contre l’oppresseur. Le seul rôle du chœur suffirait à illustrer cette dimension.
Alors que l’intérêt pour le compositeur des Oiseaux (son troisième opéra) s’était ces dernières années surtout porté sur des créations tardives comme sa Jeanne d’Arc de 1943 ou son Annonce faite à Marie de 1948, il est juste qu’un retour de balancier nous ramène au début de sa carrière. Créé à Stuttgart moins d’un an avant l’éclatement de la Première Guerre mondiale, Ulenspiegel n’avait plus jamais été rejoué avant sa recréation en 2011. On le comprend aisément : il inclut quatre personnages principaux et une vingtaine de rôles secondaires, il exige un chœur et un grand orchestre, conformément à l’esthétique post-romantique dans laquelle il fut conçu.
Produire une version chambriste de la partition est donc peut-être le meilleur moyen de la rendre abordable. On découvre ainsi une composition admirable, très proche de Richard Strauss dans ses sonorités. A aucun moment la prestation de l’Israel Chamber Orchestra ne donne lieu de regretter la réduction des effectifs à environ 35 instrumentistes, conduits par Martin Sieghart, directeur d’EntArteOpera, association fondée en 2012 pour ressusciter la musique « dégénérée ».
Cet allègement de la masse orchestrale bénéficie surtout au rôle-titre, car s’il faut saluer le courage du ténor Marc Horus, force est de reconnaître qu’il n’a peut-être pas tout à fait le format wagnérien qu’appelle l’œuvre : le chanteur déploie un maximum de vaillance malgré un très net rétrécissement du son dans l’aigu. Bien qu’abonnée aux rôles de mezzo, Christa Ratzenböck semble un peu moins éprouvée par la tessiture de Nele, unique personnage féminin de cet opéra, pourtant soumis à des exigences redoutables ; paradoxalement, le grave paraît moins sonore que les notes les plus hautes. Le Klas de Hans Peter Scheidegger paraît bien chevrotant, mais il n’a qu’une scène et son personnage est heureusement celui d’un vieillard. Pilier de la troupe de Mannheim, le baryton Joachim Goltz fait bien meilleure impression en « méchant ». Autour d’eux s’affaire toute une armée d’artistes qui cumulent plusieurs petits rôles, ainsi que l’EntArteOpera Choir, qui réussit à faire vivre cette musique même avec un nombre de chanteurs sans doute bien inférieur à celui que prévoyait Braunfels.
La mise en scène de Roland Schwab est d’une efficacité certaine : elle transpose l’œuvre dans une modernité imprécise (carcasses d'automobiles, rangers et blousons de cuir pour les oppresseurs) et l’ancre dans une réalité bien autrichienne (vestes typiques pour les hommes, jupes et corsages traditionnels pour les femmes). La brutalité de l’action est bien reflétée, même si le côté sordide de ce qu’on voit a pour contrepoint la splendeur de la musique. Espérons que cet autre Till l’Espiègle saura s’imposer à côté de son homonyme straussien. © 2017 Forum Opera (France)
1913 : l’opéra de Stuttgart voit paraître Ulenspiegel, le second opéra d’un jeune trentenaire. Il fallait oser reprendre le personnage illustré par le poème symphonique radical écrit par Richard Strauss quasiment vingt ans plus tôt. Mais enfin, Braunfels, toujours sensible à la réalité historique, et en quelque sorte contraint par son actualité, ne pouvait pas hésiter un instant devant les frasques du héros picaresque imaginé par Charles de Coster : la Grande Guerre était aux portes, autant y plonger de suite l’assistance. Le jeune musicien eut-il la prescience du trouble qui le saisirait a posteriori ? Il écrivait un opéra sur la résistance flamande protestante à l’occupation catholique espagnole. La guerre passée, il adjurerait son protestantisme pour embrasser l’Eglise de Rome. Quel étrange aller-retour, de l’historique à l’intime, passe dans cet opéra visionnaire que le compositeur délaissa : en 1920, réfugié dans la parabole d’Aristophane, ses Oiseaux le sacreraient génie du nouvel opéra allemand ; ni Prinzessin Brambilla ni Ulenspiegel n’étaient plus possibles, pire, nécessaires. L’auteur laissa la poussière recouvrir la partition et le maigre souvenir resté dans la mémoire des spectateurs s’effaça avec la Seconde Guerre mondiale.
Exhumé des archives, incarné par la scène de Linz, le voici, ce diable d’Ulenspiegel, aspergé à la mode Regietheater, avec un petit côté Blade Runner qui ne lui va pas si mal que cela. C’est gore, on saigne, mais c’est le sujet, historiquement vérifié si je puis dire, et la caméra à l’épaule ne le trahit pas, au contraire. Il faut accepter cette contrainte d’une lecture d’aujourd’hui pour réaliser à quel point Braunfels écrit la musique du théâtre lyrique allemand à venir, enjambant allégrement Richard Strauss : sa verve, son sens des atmosphères, la cruauté de son chant parlando sont déjà ce que seront demain les usages des compositeurs d’après Jonny spielt auf. Alors peu importe la réalisation brouillonne, la mise en scène politique, la troupe vaillante mais confrontée à la mémoire de grands formats vocaux qui ne se trouvent plus guère aujourd’hui, Ulenspiegel est là, devant vous, dévoilant sa sombre épopée, éclairant l’œuvre d’un compositeur majeur de l’Allemagne du XXe siècle, cette captation poursuivant un magnifique projet disco-vidéographique entrepris par Capriccio. Puissent demain nous être montés, filmés, Prinzessin Brambilla, Der Gläserne Berg et Galathea. © 2017 Avant-Scène Opéra
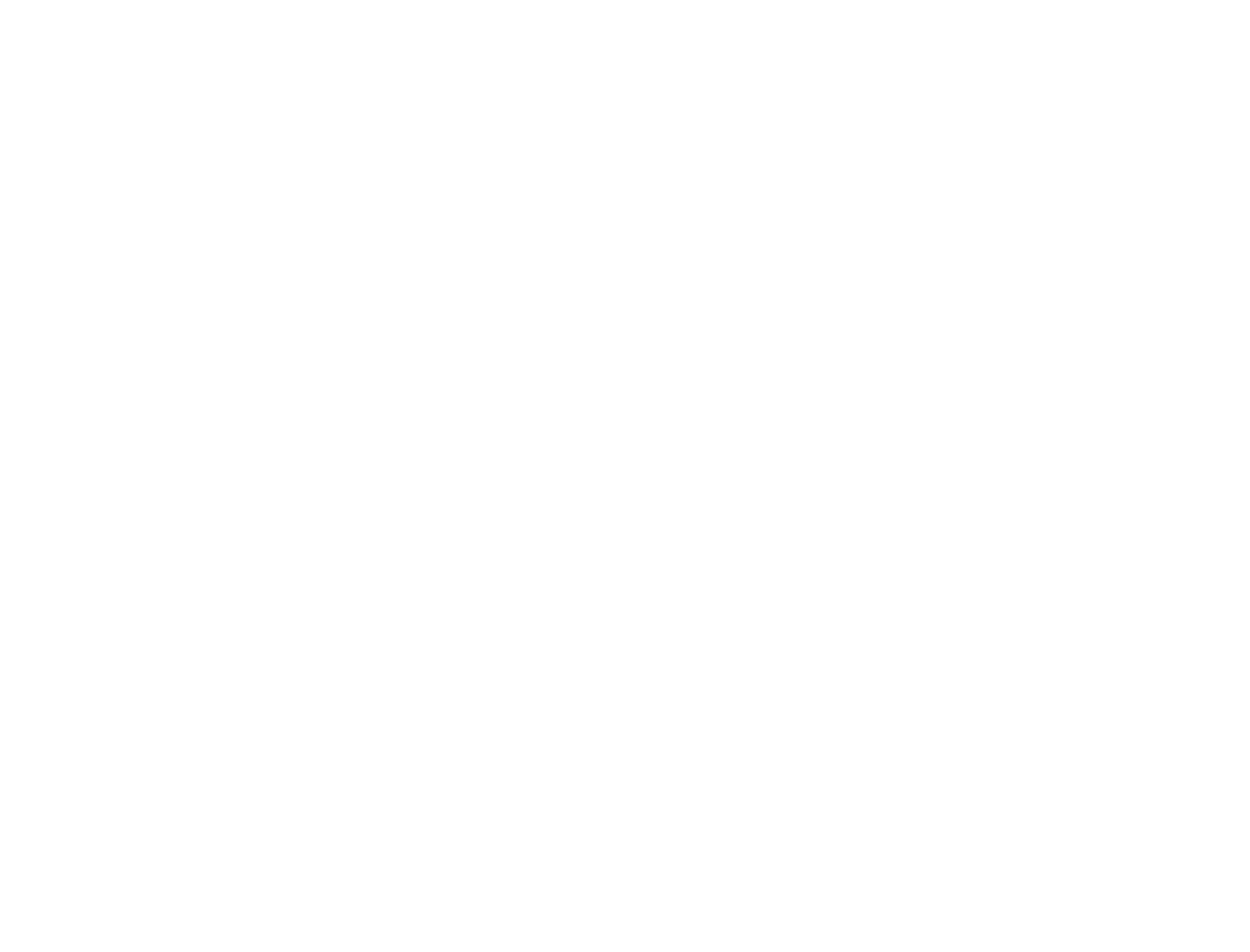











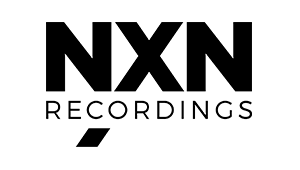








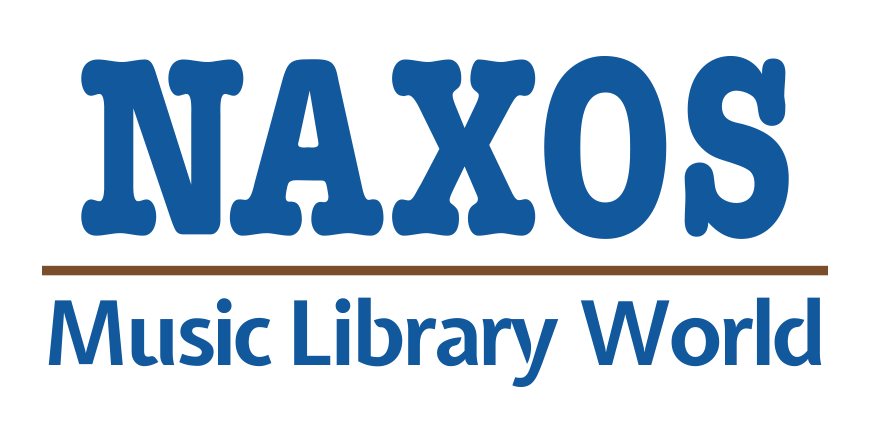
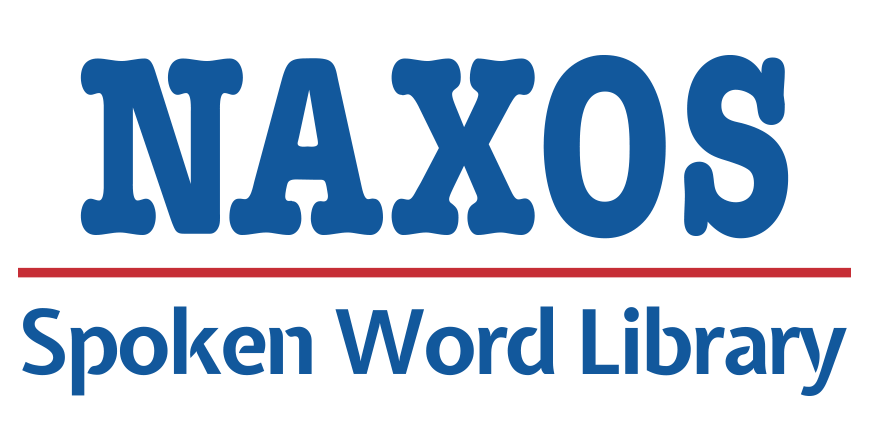








![BRAUNFELS, W.: Ulenspiegel [Opera] (EntArteOpera, 2014) (NTSC)](https://cdn.naxos.com/sharedfiles/images/cds/hires/C9006.jpg)


